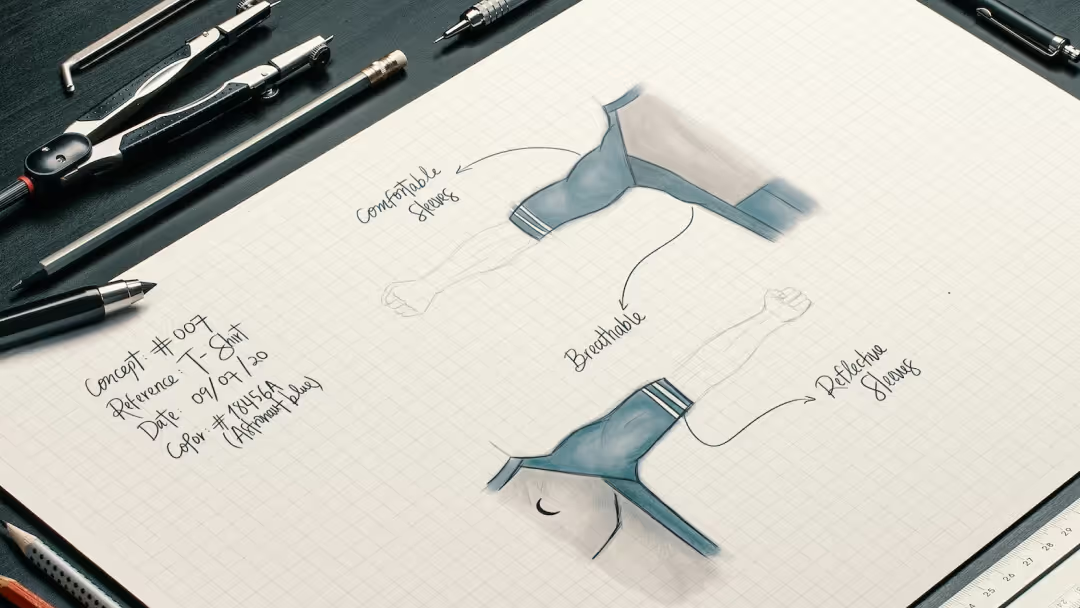L’enjeu majeur de stocker l’énergie : comprendre le défi et agir dès maintenant

Les technologies renouvelables produisent souvent de l’électricité quand nous n’en avons pas besoin. Comment stocker ce surplus pour le restituer plus tard ? Ce défi, essentiel à la transition énergétique, est abordé dans le documentaire « Stocker l’énergie : un défi technologique » d’ARTE. En s’appuyant sur les témoignages d’industriels et de chercheurs et sur les tendances du marché, cet article résume les enjeux, les solutions et les opportunités qu’offre le stockage d’énergie. Il s’adresse en particulier aux Product Managers du secteur industriel qui souhaitent comprendre comment innover et créer de la valeur.
Un défi au cœur de la transition écologiquesssss
Dans son documentaire, ARTE rappelle que l’électricité ne se stocke pas directement : il faut la transformer en une autre forme d’énergie (potentielle dans un barrage, chimique dans une batterie, mécanique dans un volant d’inertie, etc.)[1]. Lorsque le soleil brille et que le vent souffle, les installations solaires et éoliennes produisent plus qu’il n’en faut. À l’inverse, en période de « Dunkelflauten » (absence simultanée de vent et de soleil), l’absence de stockage nous oblige à allumer des centrales fossiles.
Les réalisateurs Michaela Kirst et Martin Gronemeyer montrent que les centrales hydrauliques à pompage–turbinage (STEP) constituent aujourd’hui l’essentiel du stockage mondial, avec environ 95 % de la capacité installée en 2016[2]. Ces STEP déplacent de l’eau entre deux réservoirs pour stocker l’énergie excédentaire et la restituer lors des pics de consommation, mais elles nécessitent des sites montagneux et des investissements élevés. Les batteries lithium‑ion de nouvelle génération, les volants d’inertie, les électrolyseurs pour l’hydrogène et les supercondensateurs au graphène sont également explorés[3].
Tendances et opportunités pour les acteurs du numérique industriel
Le stockage de l’énergie évolue rapidement. Les STEP dominent encore le paysage – elles représentaient 95 % de la capacité installée en 2016[2] – mais les batteries prennent de l’ampleur avec plus de 6 GW de capacités ajoutées en 2021[4]. Les coûts des batteries lithium‑ion ont chuté de 400 $/kWh en 2015 à environ 151 $/kWh en 2022[4] (aux alentours de 380 $/kwh pour de plus petite installation), les rendant attractives pour les applications de quelques heures. Cependant, les périodes sans soleil ni vent nécessitent des solutions capables de stocker de l’énergie de huit heures à plusieurs semaines[5]. Des technologies émergentes (sodium‑ion, redox‑flow, fer‑air, volants d’inertie, air comprimé, hydrogène) cherchent à répondre à ce besoin[6].
Pour les éditeurs de logiciels industriels, les ESN et les Product Managers, ces tendances sont autant d’opportunités :

- Comprendre l’écosystème et ses acteurs: au‑delà des géants des STEP, de nombreuses start‑ups et fournisseurs se positionnent sur des niches. Les projets décrits dans le documentaire – de la centrale à sels fondus chilienne aux supercapaciteurs de Skeleton Technologies – montrent la diversité des approches. S’associer à ces acteurs ou suivre leurs innovations permet de proposer des offres différenciantes.
- Placer l’utilisateur au centre: dans l’industrie, l’utilisateur final est un responsable de production ou un ingénieur qui a besoin de garanties (disponibilité, sécurité) et d’outils simples à intégrer. Les Product Managers doivent recueillir leurs besoins (temps de stockage, puissance requise) et transformer ces insights en fonctionnalités logicielles (API, tableaux de bord, alertes).
- Exploiter les données et l’interopérabilité: la multiplication des technologies impose des solutions logicielles capables de piloter et de comparer différents stockages. L’IoT et l’IA rendent possible l’arbitrage en temps réel entre différentes sources (STEP, batteries, volants), la prévision des besoins et l’optimisation des coûts.
- Contribuer à la durabilité: la sélection de composants recyclables (batteries sans cobalt, supercondensateurs à graphène) ou la mise en œuvre de cycles de réemploi améliore l’empreinte carbone. Cette exigence éthique peut devenir un avantage concurrentiel, notamment pour les clients industriels sensibles à leur impact.
À ce stade de l’article, si vous souhaitez approfondir la compréhension de ces tendances et identifier les opportunités pour votre entreprise, réservez un entretien d’analyse personnalisé avec nos consultants ou téléchargez notre guide complet sur le stockage d’énergie. Ces ressources vous aideront à transformer ces tendances en projets concrets.
Comparatif des technologies de stockage
Pour aider à choisir la technologie adaptée, voici une représentation simplifiée des principales technologie utilisées à ce jour. Les valeurs sont des ordres de grandeur issus de publications : le coût est exprimé en $/kWh de capacité installée, catégorisées par temps d'utilisation (très court terme à très long terme), selon la complexité d’installation (faible = facile à déployer, élevée = travaux importants) et son impact en terme d'emission CO2.
.png)
Pour un stockage solaire journalier (1 à 4 h), les batteries lithium-ion s’imposent par leur maturité et leur facilité de déploiement, tandis que les batteries à flux redox offrent une alternative prometteuse à moyen terme. Pour les besoins moyens (4 à 8 h), notamment liés à l’éolien ou à la gestion réseau, les redox-flow se distinguent par leur longévité, les STEP par leur robustesse si la topographie le permet, et le CAES par son potentiel sous réserve de conditions géologiques favorables. Enfin, pour le stockage de secours longue durée ou la réserve stratégique, l’hydrogène apparaît comme une piste structurante à horizon 2030, malgré un rendement encore faible ; les technologies fossiles (diesel, gaz) restent des solutions transitoires, peu compatibles avec les objectifs climatiques.
Innovations et pistes de solutions
La R&D explore de nouveaux paradigmes : batteries sodium‑ion ou fer‑air moins coûteuses et reposant sur des matériaux abondants, batteries redox‑flow à électrolyte organique, supercondensateurs au graphène ou super‑caps de Skeleton Technologies, stockage thermique par sels fondus (comme au Chili) et hydrogène vert produit par électrolyse. Des entreprises comme Form Energy construisent des batteries fer‑air aux États‑Unis[6], tandis que des start‑ups européennes perfectionnent les volants d’inertie en béton ou en carbone[10].
Ces innovations nécessitent des partenaires technologiques et des plateformes logicielles agiles. Pour les éditeurs de logiciels et les ESN, il s’agit d’intégrer ces technologies naissantes dans des applications de gestion de l’énergie, de fournir des jumeaux numériques pour optimiser leur fonctionnement et de proposer des modèles économiques (abonnement, partage de revenus) adaptés aux nouvelles chaînes de valeur.